La mort transforme la vie en destin mais, tant que nous vivons, nos histoires peuvent plus ou moins bifurquer dans une direction ou dans une autre. Entre deux sentiers, celui de gauche ou celui de droite, il est permis d’hésiter mais pas de prendre les deux à la fois. Le cinéma pourtant permet d’imaginer que nous pourrions redistribuer les cartes et donner aux personnages, aux événements un sens complètement différent, comme chez David Lynch ou seulement légèrement différent, comme ici-même.
Un film-monde
Ce film iranien de 140 minutes a la double particularité d’être tourné en un seul plan séquence et de retenir ses personnages dans une boucle temporelle où les mêmes événements se répètent avec de légères variations. Ces décalages sont minimes mais évitent la répétition pure et simple qui produirait une impression d’enfermement. Au contraire, le sentiment de liberté l’emporte et devient une idée qui s’incarne dans un destin partagé ; celui de ces étudiants venus participer à un festival de cerfs-volants et qui se retrouvent les victimes potentielles de cuisiniers cannibales.
Le choix entre la vie et la mort n’est plus fixé d’avance, de toute éternité par le metteur en scène ou le scénariste. Et si, au lieu de tourner à gauche, la jeune fille avait tourné à droite ; elle échapperait à son bourreau et rencontrerait à la place un jeune homme charmant. N’est-ce pas préférable pour elle ? Dans le premier cas, c’est un film d’horreur ; dans l’autre, c’est une comédie sentimentale. Eh bien, Shahram Mokri réussit le tour de force de présenter successivement les deux versions possibles, et même une troisième, etc.

L’habileté du cinéaste est d’éviter de nous faire croire que ces versions alternatives se produisent simultanément dans des univers parallèles. Son film est une métaphore de l’Univers, conçu comme fini et sans bord d’une part, en rebond d’autre part. Si nous pouvions atteindre en avançant dans la même direction la limite de notre Univers, nous reviendrions à notre point de départ comme à la surface d’une sphère. Ceci explique le plan-séquence et les parcours circulaires. Car il n’y a aucune discontinuité dans l’espace macroscopique qui autorise des plans de coupe.
Notre Univers à la fin finira peut-être dans un gigantesque trou noir lors du big-crunch (singularité symétrique du big-bang). Et si le trou noir se transforme à l’autre bout en fontaine blanche, toute l’information de l’Univers, depuis ses origines, au lieu d’être détruite sera restituée intacte mais s’organisera autrement dans un autre Univers, très ressemblant au précédent mais néanmoins différent. Une victime pourra échapper à son bourreau, une injustice être réparée. Une seconde chance pour tous sans que nous le sachions.
Dessiner le temps et la distance
Voilà de quoi nous parle, sans en avoir l’air, Shahram Mokri sur le film duquel souffle un vent de fin de monde mais aussi d’espoir crépusculaire. Filmés en extérieur-jour sous un ciel pale, les hommes et les femmes sont des voyageurs qui ne cessent d’arpenter le monde, sac au dos. Au milieu du bois ou au bord du lac, les vies se font et se défont au gré des rencontres. Comme il n’y a pas de réseau pour le téléphone, les portables sont inutiles et il faut que les corps se croisent pour que les paroles circulent. L’apparente futilité des propos contraste avec une certaine gravité.
Une belle fille explique : « Je dessine le temps et la distance qui se trouvent en face de moi ». C’est aussi le travail du cinéaste avec la caméra. Ce film inclassable et déroutant n’a pas d’équivalent. Le seul long-métrage qui présente quelques points communs pourrait être Charisma (1999) de Kiyoshi Kurosawa ; dans l’un et l’autre film, les acteurs évoluent dans un espace abstrait qui symbolise un cosmos, plutôt traditionnel (au Japon), plutôt conforme aux données de la science moderne (en Iran). Dans Invasion (2018), Mokri reprend le principe du plan-séquence unique.





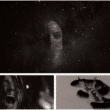




Comments are closed.