Voyez comme le cosmos sait s’organiser. Ran est le premier film de Kurosawa que je vois. Nous sommes en 2010. Cet usage du cinématographe qu’en m’évanouissant je qualifie de blblblrblr me plonge dans un état neurasthénique. Je déclare à mon psy lors d’une séance d’hypnose où, pour entrer dans une distribution libre de saucissons aux noisettes, je dois à tout prix dire ce que j’ai le cœur : « avant Ran je croyais que le ciné c’était bien ». A ces mots, mon médecin d’âme me suggère l’alcool. « Y a des gens comme ça qui ont le cafard inné, ou bien qui le chopent sévère en cours de route. Y a rien à faire. Sauf, ouais, deux ou trois bouteilles par jour. » Pendant les cinq premières années, j’ai du mal à m’y mettre. Le dernier quart de la première bouteille me reste toujours en travers et quand je veux m’enfiler la deuxième ça ne passe que par la narine droite, avec une paille en cuivre. Cette année seulement j’ai trouvé le bon compromis. Trois bouteilles par jour d’accord, mais trois bouteilles de Badoit – alcool le moins fort que je connaisse (on dirait presque de l’eau pétillante). Enfin le but est atteint : je deviens digne du nom d’alcoolique. C’est juste à temps pour que je puisse m’identifier aux héros pochtrons de L’Ange ivre.
Synopsis
Dans les bas-fonds d’un Tokyo meurtri par les ravages de la guerre, Sanada, vieux médecin débonnaire et porté sur la bouteille, reçoit la visite d’un jeune yakuza blessé par balle chez lequel il décèle la tuberculose. Mais ce dernier refuse obstinément de se faire soigner, craignant que ses pairs y voient un signe de faiblesse. Débute alors une étrange amitié.
Critique
 Dans une lettre au sujet de L’Anti-Œdipe, Gilles Deleuze explique en bref que la plupart du temps les critiques s’acharnent à descendre ou élever telle œuvre alors que la seule chose qu’ils ont à dire concrètement est : « le courant passe » ou « le courant ne passe pas ». Entre Kurosawa et moi, pour l’instant, le courant ne passe pas. Parmi les films de lui que j’ai vu, celui que je trouve le plus réussi – Les Sept samouraï – je ne l’aime que bien. J’y vois de la raison, j’y trouve des appas – d’où la persistance de ma curiosité – mais du fait de mon tempérament je ne peux pas être fou d’un cinéaste que je dirais, pour faire poli, mélancolique et formaliste. L’Ange ivre ne remet pas en cause mes impressions. Les deux protagonistes, l’un médecin acharné l’autre yakuza tuberculeux, ne s’opposent pas de la façon attendue. Kurosawa ne rejoue pas l’antagonisme vertueux contre vicieux, chaque parti à la fin ayant appris de l’autre. Au contraire il montre d’entrée de jeu que les deux personnages sont semblables – alcooliques, amers, impulsifs. Le médecin réagirait probablement de la même manière, enragée, si comme le yakuza il s’apprenait malade, et celui-ci serait on l’imagine aussi bourru et obstiné que celui-là s’il devait épauler un malade qui ne suit pas ses conseils. Ainsi ils ne se distinguent que par leur situation, et par les compétences liées : pour le médecin le savoir, pour le yakuza l’habileté physique. Ni l’un ni l’autre ne sortira enrichi, de quelque façon que ce soit, de cette rencontre. Quand le médecin dans la dernière séquence se lamente sur le sort du yakuza, c’est l’homme entier qui est invoqué – qui est décrété incurable. Bien que ce discours soit allégée par l’irruption finale d’une jeune femme qui a survécu à sa tuberculose en appliquant à la lettre les conseils du docteur, Kurosawa ne cesse dans cette conclusion d’affirmer la prégnance des déterminismes. La jeune femme survit et non le yakuza, mais ils n’ont fait que suivre ce pour quoi ils étaient programmés. On pourrait faire une gender study de ces ultimes minutes de métrage : ne serait-ce pas la virilité qui, têtue et éduquée à suivre ses mauvais penchants, échoue face au féminin, plus docile ? Le diagnostic final est fatal. On ne peut se guérir de soi-même.
Dans une lettre au sujet de L’Anti-Œdipe, Gilles Deleuze explique en bref que la plupart du temps les critiques s’acharnent à descendre ou élever telle œuvre alors que la seule chose qu’ils ont à dire concrètement est : « le courant passe » ou « le courant ne passe pas ». Entre Kurosawa et moi, pour l’instant, le courant ne passe pas. Parmi les films de lui que j’ai vu, celui que je trouve le plus réussi – Les Sept samouraï – je ne l’aime que bien. J’y vois de la raison, j’y trouve des appas – d’où la persistance de ma curiosité – mais du fait de mon tempérament je ne peux pas être fou d’un cinéaste que je dirais, pour faire poli, mélancolique et formaliste. L’Ange ivre ne remet pas en cause mes impressions. Les deux protagonistes, l’un médecin acharné l’autre yakuza tuberculeux, ne s’opposent pas de la façon attendue. Kurosawa ne rejoue pas l’antagonisme vertueux contre vicieux, chaque parti à la fin ayant appris de l’autre. Au contraire il montre d’entrée de jeu que les deux personnages sont semblables – alcooliques, amers, impulsifs. Le médecin réagirait probablement de la même manière, enragée, si comme le yakuza il s’apprenait malade, et celui-ci serait on l’imagine aussi bourru et obstiné que celui-là s’il devait épauler un malade qui ne suit pas ses conseils. Ainsi ils ne se distinguent que par leur situation, et par les compétences liées : pour le médecin le savoir, pour le yakuza l’habileté physique. Ni l’un ni l’autre ne sortira enrichi, de quelque façon que ce soit, de cette rencontre. Quand le médecin dans la dernière séquence se lamente sur le sort du yakuza, c’est l’homme entier qui est invoqué – qui est décrété incurable. Bien que ce discours soit allégée par l’irruption finale d’une jeune femme qui a survécu à sa tuberculose en appliquant à la lettre les conseils du docteur, Kurosawa ne cesse dans cette conclusion d’affirmer la prégnance des déterminismes. La jeune femme survit et non le yakuza, mais ils n’ont fait que suivre ce pour quoi ils étaient programmés. On pourrait faire une gender study de ces ultimes minutes de métrage : ne serait-ce pas la virilité qui, têtue et éduquée à suivre ses mauvais penchants, échoue face au féminin, plus docile ? Le diagnostic final est fatal. On ne peut se guérir de soi-même.
 De fait la mort est une libération. Lorsque, poignardé par son ennemi, le yakuza s’échoue sur un balcon, Kurosawa nous fait sentir un petit vent frais. Le quartier de L’Ange ivre nous est généralement dépeint, par un travail soigneux niveau photographie sur les ombres d’été, comme moite et chaud, en haut le soleil de midi en bas les fossés bourbeux où le typhus nage. Le plan terminal du yakuza est le seul à nous offrir un moment d’air. Non seulement des vêtements étendus sur une corde à ligne battent au vent mais en plus la vue est en plongée, ce qui induit une possible élévation. Ce moment de fraîcheur est d’autant plus saillant que le reste du film est structuré par un motif inlassable : la rayure. Ça point particulièrement quand la séquence où le médecin analyse la radio des poumons du yakuza laisse place à une autre séquence où le médecin délibère avec son assistante tandis que le soleil bas essaie de percer à travers les stores, marquant de grosses lignes noir sur blanc le décor et les personnages. Ces lignes répondent visuellement aux lignes blanc sur noir de la cage thoracique dans l’image radiographique. Dès lors nous sommes invités à repérer le motif et ce motif est plus ou moins de chaque plan, ne serait-ce que parce que notre yakuza porte une chemise rayée et une cravate encore pire. Kurosawa par ce biais enfonce le clou : le monde matériel est une prison, on y est forcément malade ; laissons pour notre joie nos âmes rejoindre les nuages. D’ailleurs il ne pourra s’empêcher aux deux tiers d’expliciter l’analogie en faisant dire à son docteur que le poumon du yakuza ressemble terriblement à ce misérable quartier.
De fait la mort est une libération. Lorsque, poignardé par son ennemi, le yakuza s’échoue sur un balcon, Kurosawa nous fait sentir un petit vent frais. Le quartier de L’Ange ivre nous est généralement dépeint, par un travail soigneux niveau photographie sur les ombres d’été, comme moite et chaud, en haut le soleil de midi en bas les fossés bourbeux où le typhus nage. Le plan terminal du yakuza est le seul à nous offrir un moment d’air. Non seulement des vêtements étendus sur une corde à ligne battent au vent mais en plus la vue est en plongée, ce qui induit une possible élévation. Ce moment de fraîcheur est d’autant plus saillant que le reste du film est structuré par un motif inlassable : la rayure. Ça point particulièrement quand la séquence où le médecin analyse la radio des poumons du yakuza laisse place à une autre séquence où le médecin délibère avec son assistante tandis que le soleil bas essaie de percer à travers les stores, marquant de grosses lignes noir sur blanc le décor et les personnages. Ces lignes répondent visuellement aux lignes blanc sur noir de la cage thoracique dans l’image radiographique. Dès lors nous sommes invités à repérer le motif et ce motif est plus ou moins de chaque plan, ne serait-ce que parce que notre yakuza porte une chemise rayée et une cravate encore pire. Kurosawa par ce biais enfonce le clou : le monde matériel est une prison, on y est forcément malade ; laissons pour notre joie nos âmes rejoindre les nuages. D’ailleurs il ne pourra s’empêcher aux deux tiers d’expliciter l’analogie en faisant dire à son docteur que le poumon du yakuza ressemble terriblement à ce misérable quartier.
Bref, on ne pourra pas dire que Kurosawa est un branleur. Tout ça est mis en scène. Tout ça est bien fichu. C’est du cinéma classique au sens fort. Mais le classicisme, en proposant des films lisibles, sciemment organisés pour faire converger le sens, du coup parfaits pour les exercices d’analyse filmique de ta licence arts et spectacle, engendre cela : soit on adhère à la vision et c’est le kif, soit on adhère pas et il ne reste qu’à admirer l’habileté de loin. Par cette voie on peut démontrer que L’Ange ivre n’est pas un sommet de l’oeuvre de Kurosawa. Cinéaste classique, il cherche à proposer une oeuvre unifiée. Pour parler scolairement, à lier fond et forme, à faire résonner thématique et esthétique. Or il y a dans cet opus un désaccord entre les écritures, entre les efforts de stylisation et le réalisme persistant de l’affaire. Le contexte de L’Ange ivre n’est pas un bon support pour l’harmonie de l’entreprise Kurosawa. Tout systématiquement s’empêche. Toshiro Mifune, interprète du yakuza, joue et est maquillé comme un acteur expressionniste alors que le reste de la direction artistique tend vers le naturalisme. Kurosawa cherche la picturalité des plans mais en même temps n’a la plupart du temps qu’à filmer des monsieurs normaux qui parlent dans des maisons normales. Je n’ai rien contre les films composites, bien au contraire, mais en l’occurrence L’Ange est composite par défaut, comme si le cinéaste n’avait pas d’entrée de jeu osé aller au bout de sa méthode. Les meilleures séquences du film sont pourtant celles où il se laisse aller à ses plaisirs de mise en scène, telle la scène de baston en couloir entre le yakuza et son ennemi. Là plus rien ne le bride dans ses jeux d’espaces et de cadres. C’est qu’à ce moment on quitte le statique pour le dynamique, l’étude de caractère pour les corps en tension.
 Il faut noter le joli travail de Wild Side cette réédition DVD Bluray (pour certains films édition tout court) des films de Kurosawa à la Toho. La restauration est bienvenue et se fait apparemment dans le respect des desseins du cinéaste. L’Ange ivre en outre est accompagné d’un beau livret introductif rédigé par Charles Tesson et de deux bonus assez consistants, un documentaire sur la genèse du film intitulé Akira Kurosawa contre Toshiro Mifune et une petite intervention critique, rafraîchissante car honnête et nuancée, par Jean Douchet. Dans ces trois documents supplémentaires, on voit nos intuitions confirmées. On y insiste sur le fait que c’est le « premier film » de Kurosawa – non pas littéralement, puisqu’il a en 1948 déjà une dizaine de films à son actif, mais esthétiquement : enfin le cinéaste, libéré des contraintes induites par la guerre, organise l’équipe d’acteurs et techniciens qui sera bientôt responsable de ses plus grands films et par là trouve une voix qui lui appartient en propre. Mais c’est à peu près tout ce qu’on dit. Ce ne sera pas le cas pour les films suivants, qui bénéficient dans la même collection d’analyses extrêmement précises. Le prétexte du « premier film » (assez ennuyeux du reste : il vaudrait mieux je crois regarder chaque œuvre pour ce qu’elle est) paraît alors comme un cache, qui dissimule la faiblesse relative de l’opus. À défaut d’être un excellent film, L’Ange ivre nous disent-ils est un excellent document pour qui s’intéresse au cinéaste.
Il faut noter le joli travail de Wild Side cette réédition DVD Bluray (pour certains films édition tout court) des films de Kurosawa à la Toho. La restauration est bienvenue et se fait apparemment dans le respect des desseins du cinéaste. L’Ange ivre en outre est accompagné d’un beau livret introductif rédigé par Charles Tesson et de deux bonus assez consistants, un documentaire sur la genèse du film intitulé Akira Kurosawa contre Toshiro Mifune et une petite intervention critique, rafraîchissante car honnête et nuancée, par Jean Douchet. Dans ces trois documents supplémentaires, on voit nos intuitions confirmées. On y insiste sur le fait que c’est le « premier film » de Kurosawa – non pas littéralement, puisqu’il a en 1948 déjà une dizaine de films à son actif, mais esthétiquement : enfin le cinéaste, libéré des contraintes induites par la guerre, organise l’équipe d’acteurs et techniciens qui sera bientôt responsable de ses plus grands films et par là trouve une voix qui lui appartient en propre. Mais c’est à peu près tout ce qu’on dit. Ce ne sera pas le cas pour les films suivants, qui bénéficient dans la même collection d’analyses extrêmement précises. Le prétexte du « premier film » (assez ennuyeux du reste : il vaudrait mieux je crois regarder chaque œuvre pour ce qu’elle est) paraît alors comme un cache, qui dissimule la faiblesse relative de l’opus. À défaut d’être un excellent film, L’Ange ivre nous disent-ils est un excellent document pour qui s’intéresse au cinéaste.










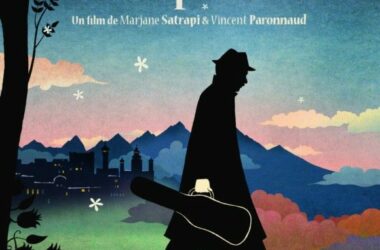

Comments are closed.