La Llorona (la pleureuse) est une légende latino-américaine qui a surtout inspiré le cinéma mexicain et se retrouve récemment à l’honneur sur les écrans. En 2019, sortait à Paris The Curse of La Llorona (La Malédiction de la dame blanche) accueilli dans l’ensemble comme un film d’horreur standard, sans grande originalité. Aujourd’hui, le nouveau film de Jayro Bustamante, le troisième d’un triptyque (après Ixcanul et Temblores) réinvestit complètement le récit légendaire, non pour le trahir, mais pour en dégager une signification nouvelle, liée à la période de la guerre civile (1960-1996) au Guatemala. Ce discours politique est également rattaché à la question de la mémoire que l’on ne doit pas confondre avec l’Histoire. Passons d’abord en revue les autres versions de La Llorona tournées au Mexique et voyons ensuite le fort et le faible du film de Bustamante dans le contexte actuel.
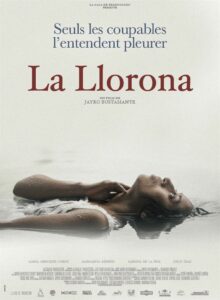
La Llorona (1933, Ramon Peon) est un classique du cinéma mexicain, inspiré des Early Horrors made in USA comme The Bat Whispers (1930). Le film alterne des séquences modernes (mais à ambiance gothique) impliquant crimes, rapt d’enfant et nourrice criminelle avec deux flashbacks présentant des variantes de la légende : dans le premier, une femme indigène repoussée par son amant européen pendant la période coloniale, tue son enfant et se suicide. Dans le second, La Malinche est la maîtresse d’un conquistador qui lui retire son enfant naturel; elle devient folle et se suicide. Suicide par désespoir dans les deux cas, infanticide fantasmé avec ou sans passage à l’acte selon le degré de folie provoquée par l’état d’asservissement racial et sexuel.
La herencia de la Llorona (1946, Mauricio Magdaleno) présente une mère disparue, éloignée volontairement, envoyée à l’étranger par un mauvais fils et qui, frappée de folie passagère, revient au pays en terrorisant involontairement sa fille qui la prend pour une morte-vivante. Mais la pleureuse recouvre la raison et réintègre sa famille.
La Llorona (1959, René Cardona), comme la version des années 30, met en parallèle, passé et présent. La Femme qui pleure est le symbole du peuple Indien qui trahit sa lignée en devenant la maîtresse du conquérant dont, par remords, elle tue un enfant après avoir été répudiée. Magicienne vengeresse – comme Médée – mais néanmoins victime (elle finit pendue), elle se réincarne à l’époque moderne en nourrice des descendants de ses propres enfants survivants. Plutôt que de s’en prendre directement au petit garçon, elle le met à plusieurs reprises en danger, sans pourtant provoquer sa mort. L’ambiguïté de ce comportement reflète bien le caractère ambivalent de la pleureuse, parfois meurtrière, toujours victime et folle de douleur muette.
Dans la version contemporaine guatémaltèque, Bustamante respecte en tout point les lignes de force de l’histoire mythique. La Llorona est une femme Maya engagée comme domestique dans une famille blanche qui la charge de l’éducation de la petite Ana, à peine cinq ans. Le père, ancien chef militaire soupçonné de massacres sur la population indienne, n’est pas insensible au charme féminin indigène, et pourrait bien être le père (ou le grand-père) des enfants disparus de la domestique. Celle-ci cherche-t-elle, par vengeance, à noyer la petite fille ou au contraire à la sauver ? Figure exténuée et pâle, Alma se détache du groupe des manifestants et s’introduit dans la famille, comme élément étranger mais aussi étrangement proche. Le drame intime est souligné par le silence, la souffrance dissimulée et la violence contenue.
Les séquences où le père entend au milieu de la nuit les sanglots étouffés de la pleureuse, son périple dans la vaste demeure à la recherche de l’origine du bruit, sa rencontre plus tard avec Alma errant dans les couloirs comme un fantôme ou nue dans la salle de bain, nettoyant sa robe, témoignent de la maîtrise du réalisateur, de sa capacité à créer une ambiance de réalisme magique. Lorsqu’un des disparus, impassible, se mêle à la foule des manifestants ou quand ces derniers surgissent brusquement tels des zombies dans le parc privé, ce sont là des images fortes d’un film fantastique sachant ordonner ses effets en évitant la surenchère. L’usage de l’élément liquide (amniotique, évier, baignoire, piscine, rivière, pissotière, jusqu’à la l’incontinence de la mère) comme milieu conducteur de la naissance et de la mort culmine dans la scène où la petite Ana arrache le masque au père endormi pour pouvoir respirer sous l’eau; la signification de cet acte étrange est donnée à la fin dans un flashback accusateur.
Malgré ses qualités formelles, le film peine à convaincre, non pas de la réalité des massacres et des souffrances d’un peuple, mais de la culpabilité unilatérale des élites politiques et militaires. Les chiffres avancés sont les suivants : 250 000 personnes sont mortes, 40 000 ont disparu, 100 000 ont été déplacées. La majorité de ces victimes étaient des civils. Que les régimes en place qui se sont succédé, la plupart du temps des dictatures militaires soutenues par les Etats-Unis et par Israël, soient les principaux responsables, c’est probable et ce sont là des questions d’Histoire, méconnues en Europe et qui méritent d’être posées au-delà des frontières. Mais, au lieu d’en appeler à la réflexion critique de son public, le réalisateur place directement le vieux général en position de monstre sanguinaire; nous sentons la culpabilité peser de tout son poids et suinter de tous les membres. A aucun moment, le doute n’est ménagé sans pourtant que les motifs précis de l’accusation soient connus. Il y a des milliers de disparus et les familles manifestent leur colère, mais un disparu est-il nécessairement un assassiné ? Quand l’avocat au procès exige des preuves matérielles du génocide, n’est-ce pas conforme au droit, non seulement de la défense de son client, mais aussi à celui du jury (les spectateurs) qui est, en quelque sorte, pris en otage et conduit à croire en la faute des uns et l’innocence des autres, sans rien connaître du dossier. On dira que le film invite à s’y plonger mais il infléchit trop le jugement du public en jouant uniquement sur l’aspect émotionnel.
C’est la limite du discours d’un cinéaste engagé qui écrit cependant lucidement dans le document de l’AFCAE : « On parle de génocide mais des crimes de guerre ont été commis des deux côtés« . De cela on peut être certain et c’est le débat historique qui devrait prévaloir sur les lamentations de la Llorona et les incantations de la mémoire qui attisent les ressentiments et obscurcissent les esprits.




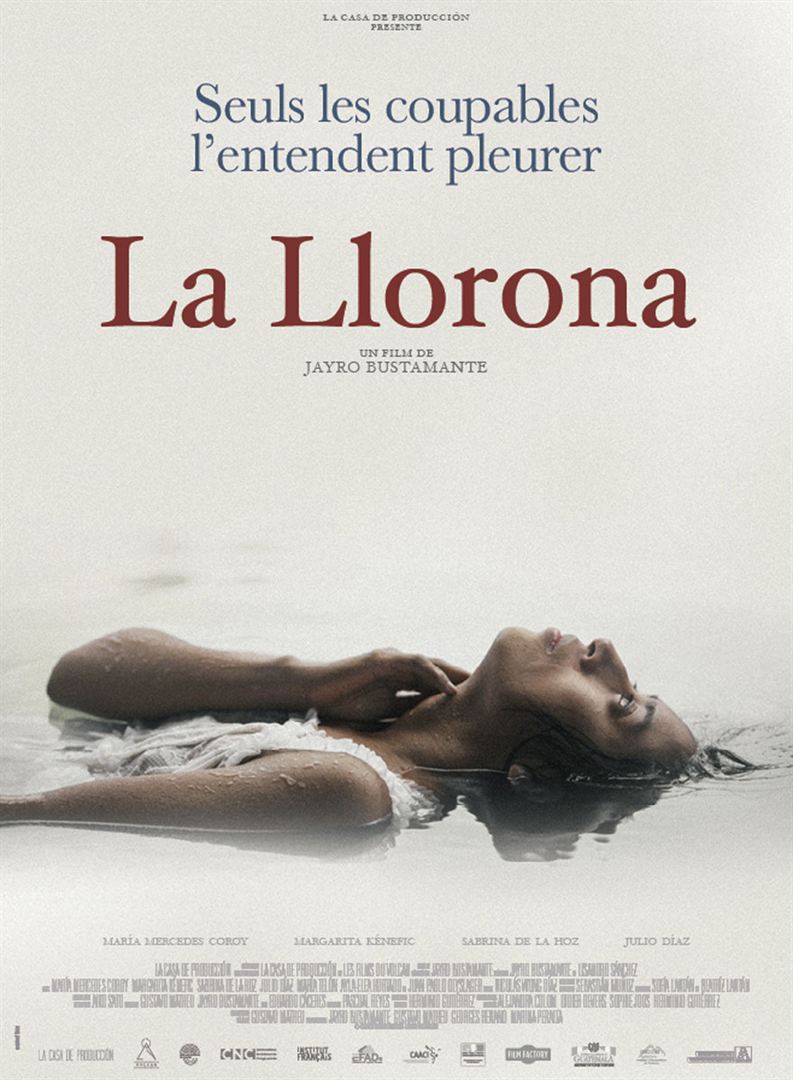





Comments are closed.