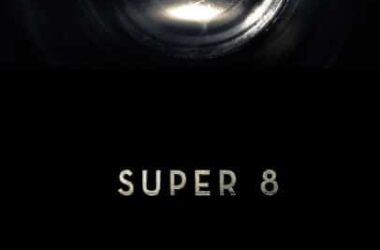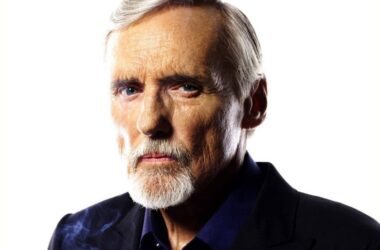Le respect des codes
Le scénario est classique. Tout commence par un geste de « légitime défense » : un robot assassine son propriétaire qui voulait le détruire. Exploités par les hommes, les robots finissent par se révolter sur le modèle des noirs Américains des années 1960. Le scénariste légitime la révolte des machines en les humanisant. Il en fait une minorité ethnique humiliée. Ensuite, les machines, qui imitent les hommes, revendiquent leur propre territoire organisé sous forme d’Etat (Zero-One). Les néo-Africains deviennent des néo-sionistes. Une fois bien implantées, les machines renforcent leur pouvoir économique en développant le commerce international. Mais le mode de production étant devenu trop complexe en raison de la mondialisation des échanges et trop technique pour les humains, les machines se transforment en nation concurrente puis rivale de toutes les autres. Elles demandent d’abord à être acceptées dans le concert des nations en conservant leur singularité. Puis elles font les lois et imposent un mode de gouvernement, entièrement technocratique. La guerre éclate et les humains commettent des destructions de machines, des « massacres ». Les machines reprenant le dessus, les humains construisent un dôme pour empêcher le soleil d’alimenter les circuits (qui fonctionnent à l’énergie solaire). Pour survivre, les machines s’exilent dans le désert et réduisent les hommes à l’état de légumes dont elles absorbent la substance vitale. Les hommes doivent se réveiller d’un monde de simulacres dans lequel ils sont plongés pour rejoindre une cité du désert (Zion) qui attend l’élu qui va les délivrer.
Connaître les codes informatiques, au moins savoir les lire sinon les modifier, permet aux initiés de supprimer un élément du décor ou le changer complètement et peut-être même le déroulement de l’histoire. Mais il est d’autres codes intangibles que les scénaristes respectent, ceux du politiquement correct dans l’industrie du rêve. Quand on parle de blancs, de noirs ou de sionistes, on peut procéder à tous les retournements possibles de situation, mais les codes resteront inchangés. Deux exemples le montreront à partir de postulats.
Postulat n°1 : Les noirs sont bons, les blancs sont mauvais. Les machines qui se révoltent contre la tyrannie de leur fabricants et utilisateurs (des blancs éduqués) sont comme le prolétariat africain. Mais une fois le nouveau pouvoir en place avec toutes ses horreurs, les machines génèrent des agents (Smith) ou des robots (l’architecte) qui sont des caricatures de blancs arrogants. Le plus ridicule des programmes obsolètes est incarné par le Mérovingien qui parle un français de bazar. Morpheus, le grand prêtre de la prophétie est un noir et la foule des déconnectés visible à la rave party évoque une humanité métisse. De toute évidence, les races se sont mélangées et les blancs minoritaires ont tendance à disparaître. Le peuple de l’avenir, libérateur de l’humanité, n’a plus d’identité nationale ou ethnique.
Postulat n°2 : Les sionistes sont bons, les antisionistes sont mauvais. Au début, les nations existaient encore. Pour échapper aux massacres (perpétrés par les hommes esclavagistes), les machine veulent constituer une nation comme les autres qui sera leur refuge et leur base pour la conquête du monde par le commerce. Mais elles ne sont pas vraiment une nation « comme les autres ». Elles imitent les hommes mais bientôt les dépassent par leurs compétences techniques et les contrôlent. Nouveaux « massacres » des néo-antisionistes, éternels jaloux. Puis les hommes couvrent le ciel, obligeant les machines à la domination la plus barbare. C’est alors que les néo-sionistes changent de camp. Le petit peuple irréductible devient celui des hommes libres habitant la ville de Zion. Les nations ont disparu de la surface de la Terre ; n’existe qu’un seul peuple humain qui se croit libre : celui, interracial, des déconnectés de la matrice. Leur élu s’appelle Néo mais la prophétie se révélera être un leurre.
Ces exemples montrent l’habileté des scénaristes. Il est bien question d’hommes et de machines et le discours porte aussi, surtout parait-il dans le troisième opus, sur une réconciliation des deux camps, une collaboration qui s’amorce dans les échanges d’informations entre Néo et Smith, Smith n’étant plus un agent mais un programme exilé. Il y aurait ainsi, pour certains observateurs, l’ébauche d’un débat cyberpunk sur l’émergence d’une race mutante, mi-homme mi-machine. Pourquoi pas ? Mais ce qui retient l’attention ici, c’est la façon dont le code est respecté à la lettre. Les néo-Africains cessent de ressembler à des noirs quand ils se comportent mal. Et les néo-sionistes cessent de l’être quand ils vont trop loin. Autrement dit, il est possible de critiquer un abus de pouvoir, une tentation hégémonique, tant que certains marqueurs se déplacent. Les codes dont nous parlons ne sont pas des combinaisons de symboles sous formes de filaments verdâtres mais un ensemble de règles non écrites qui régissent le politiquement correct dans le cinéma (censurant les dessins animés de Tex Avery). Elles sont parfaitement respectées dans les deux films.
Hyperréalisme
Pourquoi cette atmosphère d’hyperréalisme dans le cinéma contemporain américain, notamment celui du Kubrick ou de David Lynch mais aussi celui des Wachowski ? Au-delà d’un travail technique sur l’image, il y a un certain fétichisme des codes attachés aux principaux genres moribonds. Les conventions du film noir, par exemple, sont à ce point usées que leur usage exacerbé en vient à renouveler le genre dans une posture post-moderne qui peut irriter ou enthousiasmer. Comme Lynch parvient avec talent à mélanger tous les genres dans son Mulholland Drive, sans ironie grinçante, beaucoup de spectateurs crient au génie. De façon similaire, les Wachowski fabriquent leur cocktail, à cette différence que l’enveloppe du produit fini est clairement estampillée science-fiction, avec un chouia de kung-fu. Mais le bouillon de culture est dans le sac sans fond du producteur. Quand on n’a pas lu Platon, la Bible ou René Guénon, on peut toujours voir les Matrix ; on aura l’impression de réfléchir tout en se divertissant. Mais la bonne nouvelle, à porter au crédit du système Matrix, c’est qu’on ne fait pas semblant ; La réflexion n’est pas un simulacre.
Dans une de ses nouvelles, Borges imagine une carte si précise qu’elle est à l’échelle du territoire dont elle finit par recouvrir toute la surface. La contrée réelle n’est plus visible et finit par disparaître complètement tandis que les ruines sont celles du papier qui s’use et s’effrite. Dans Matrix, la carte numérique est high-tech et inusable. Le monde qu’elle masque échappe à la décadence puisqu’il n’existe pas indépendamment du code. Il y a bien le danger des virus et des programmes obsolètes réfugiés dans les replis du disque dur, mais il n’affecte pas le monde des apparences, toujours aussi rutilant, plein de bruit et de fureur. Un vrai film d’action. Il n’y a pas que dans Matrix ; dans nos sociétés – ouvertes aux flux migratoires et financiers – les images précèdent désormais le réel. Le déficit de réel, qui s’explique notamment par la perte de souveraineté des peuples et du sens du bien commun, crée un faux réel par l’usage déréglé des « réalités » virtuelles. Ce n’est plus la carte qu’on dessine à partir du territoire mais le territoire qu’on reconstitue comme la projection en relief d’une carte préexistante. D’où cette impression d’hyper-réalité en même temps que d’espace indifférencié. Faut-il, pour appréhender l’espace, marcher au plafond ou s’immobiliser en l’air comme l’acteur principal ? En tout cas, les clichés sont bien utiles car ils constituent des points de repères pour le spectateur égaré.
Arrêtons de nous plaindre ; nous vivons peut-être à l’âge des images de synthèse et des simulacres de démocratie, mais ce n’est pas la faute à Hollywood. Et puis, si nous en venons si souvent à douter de la réalité, disons substantielle, de notre environnement, c’est bon signe. La question de la réalité de notre monde n’est pas seulement angoissante, elle renvoie aussitôt à l’Autre absolu du monde (l’Un, le Réel) qui résiste au savoir et projette sur l’ensemble de notre « réalité » une atmosphère d’étrangeté, d’étonnement. Si le monde devient hyper-réel, c’est qu’il est déconnecté du Réel. Il faut donc, dans le film, se déconnecter pour accéder à une autre réalité.
Oui, mais quid si le monde de l’Architecte et celui des débranchés s’avèrent eux aussi faire partie de la simulation ? Tout cela est révélé dans Matrix II, je n’y reviendrai pas, les commentaires sont légions. Dans ce cas, comment est-il possible de représenter littéralement l’Architecte, la pièce où il se trouve tapissée d’écrans, les couloirs aseptisés derrière le décor urbain, les portes ? Comment est-il possible de représenter le monde de Zion, son vaisseau aérien, sa ville dans le désert, ses cérémonies primitives, ses chefs et son élu ? Puisque nous sommes toujours dans le monde du simulacre, ces ombres sont dérisoires. L’Architecte a beau exhiber une belle barbe et un costume immaculé, ce n’est pas un dieu ; au mieux un démiurge qui s’assure de la bonne réinitialisation de la machine. Mais rien n’indique qu’il ait lui-même écrit le programme et connaisse parfaitement le logiciel. L’Architecte porte quelques signes extérieurs de la divinité mais il est plus simplement un androïde sophistiqué et méprisant les humains, un informaticien doué qui récite sa leçon bien apprise devant Néo. Pour qui travaille-t-il, si la question a un sens, nous ne le saurons pas.
Lire la suite de l’analyse en page 3
Vous pensez en savoir plus que nous ? Donnez nous votre avis en commentaire pour participer aux analyses et explications de films !